On s’attache à expliquer ou prévoir de manière systématique la réussite d’un plan d’entraînement par la seule lecture des séances réalisées. Trop de seuil, pas assez d’allure marathon, pas assez de km…Combien de fois met-on en avant de tels arguments pour comprendre pourquoi, cette fois-ci, la préparation n’a pas payé… Et si l’explication était ailleurs ?
ÉLARGIR SON ANGLE DE VUE :
 Il est peut-être temps de penser différemment la performance, en s’inspirant d’une nouvelle manière de concevoir la santé qui est en train d’émerger. De quoi s’agit-il ?
Il est peut-être temps de penser différemment la performance, en s’inspirant d’une nouvelle manière de concevoir la santé qui est en train d’émerger. De quoi s’agit-il ?
D’un mouvement, encore minoritaire, qui se réfère à un mode de réflexion, connu sous l’expression de la « pensée complexe ». « Complexe » n’a pas ici le sens de compliqué, mais vise plutôt à rendre compte de l’absence de compartimentation de nos fonctions, à dénier la constitution de notre corps en autant de tiroirs ou de fonctions indépendantes les unes des autres. En fait la « pensée complexe » est caractéristique du vivant.
Cette pensée complexe aide à décrypter le monde et l’homme dans ce monde. Comment se caractérise ce mode de raisonnement ? Il aspire à la connaissance multidisciplinaire, multidimensionnelle. Par elle, on essaie, par exemple dans le domaine médical, de distinguer les différents fils, de les analyser, de les conjuguer, pour comprendre les relations d’interdépendance et reconstruire l’histoire de la pathologie. Ce sont surtout les approches dites « alternatives » qui procèdent ainsi.
La pensée complexe repose sur plusieurs principes. D’abord, la « somme des parties n’est pas le tout ». Ceci signifie que réfléchir par spécialité pour comprendre un échec sportif n’est pas satisfaisant. On peut prendre un exemple précis dans le domaine de l’entraînement, où on a souvent recours aux stages en altitude pour favoriser la synthèse de globules rouges, parce qu’on considère qu’un plus grand nombre de globules rouges est, indépendamment de tout le reste, un élément-clef d ans la réalisation de grandes performances. Ceci est évidemment loin d’être évident. D’ailleurs, on sait pourtant, comme divers travaux l’ont établi, que certains stages d’entraînement à 2000 m peuvent déboucher sur des résultats contraires à ceux recherchés. Ainsi, l’étude de Warrington menée en 1996, trouva une chute moyenne très significative du taux d’hémoglobine des membres de l’équipe britannique féminine d’aviron partie préparer les Jeux en altitude. Après coup, cet effet paradoxal a été attribué aux déficits martiaux initiaux qui n’avaient pas été pris en compte et auraient empêché la fabrication en quantité suffisante de nouveaux globules rouges chez ces athlètes déficitaires en fer.
De ce fait, il est devenu de plus en plus fréquent de proposer une prise de fer systématique à titre anticipatoire à tout le monde, ce qui peut avoir des répercussions néfastes chez un certain nombre de sujets, notamment ceux qui sont exempts de déficit au début du stage ou connaissent des problèmes inflammatoires chroniques. Cela s’inscrit en outre dans une logique plutôt critiquable, dans le sens où ce geste médical n’est plus proposé à des fins de santé, mais uniquement dans une logique (très aléatoire d’ailleurs) de performance. Une réflexion s’appuyant sur la pensée complexe doit aller au-delà et donc, de facto, déboucher sur une prise en charge individualisée de l’athlète. On va établir au cas par cas non seulement qui pourrait bénéficier d’un tel séjour dans les cimes, mais en outre qui, parmi ces candidats potentiels, est dans un état physiologique impropre à en tirer des avantages. Ceci étant posé, on comprend qu’il est tout aussi faux d’affirmer que l’altitude marche que de dire qu’elle ne sert à rien. Tout dépend, encore une fois, de l’aptitude du sujet à répondre.
Ce mode de raisonnement par la « pensée complexe » repose sur un autre principe très important selon lequel il existe, dans notre prise de décision et dans notre analyse, une partie subjective qui est intégrée à l’analyse objective, ce que les entraîneurs savent très bien, eux qui parlent souvent d’expérience ou d’intuition, tout comme les athlètes qui parfois s’entraînent au feeling, et refusent les modélisations conventionnelles.
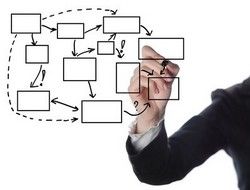 Dans cette approche, on peut s’interroger sur la contre-performance d’un athlète de manière globale, en intégrant sa pratique à sa vie de tous les jours, et non plus seulement en regardant le contenu des séances. Ni en s’attardant exclusivement sur des critères objectifs tels que les charges d’entraînement ou tous les systèmes de calcul qui visent à quantifier les contraintes physiologiques subies par l’athlète. Pourquoi quantifier les charges de travail, en heures, en km ou sous d’autres formes plus sophistiquées, peut-il paraître limitatif ? Car de tels critères, fussent-ils capables d’évaluer très finement les quantités d’entraînement effectuées, n’intègrent que ce qui a trait à l’exercice et ramènent tout à lui, et ne prennent en compte ni les réponses qui fondent l’adaptation individuelle ni, en outre, l’influence d’éléments extérieurs parfois très déterminants.
Dans cette approche, on peut s’interroger sur la contre-performance d’un athlète de manière globale, en intégrant sa pratique à sa vie de tous les jours, et non plus seulement en regardant le contenu des séances. Ni en s’attardant exclusivement sur des critères objectifs tels que les charges d’entraînement ou tous les systèmes de calcul qui visent à quantifier les contraintes physiologiques subies par l’athlète. Pourquoi quantifier les charges de travail, en heures, en km ou sous d’autres formes plus sophistiquées, peut-il paraître limitatif ? Car de tels critères, fussent-ils capables d’évaluer très finement les quantités d’entraînement effectuées, n’intègrent que ce qui a trait à l’exercice et ramènent tout à lui, et ne prennent en compte ni les réponses qui fondent l’adaptation individuelle ni, en outre, l’influence d’éléments extérieurs parfois très déterminants.
Par exemple, comment est vécu le même entraînement chez un athlète confronté à un deuil, à un divorce ou à une infection ?
Précisément, les observations que nous avons compilées dans le cadre du suivi de sportifs de haut niveau, nous montrent que, hormis en cas de franches aberrations dans l’entraînement, les principales causes de « surentraînement »- terme à notre sens inapproprié pour rendre compte de l’état d’épuisement rencontré (*)-, sont plutôt liées à des carences nutritionnelles, à des stress mal gérés, à des problèmes d’infection, d’inflammation, d’intolérance alimentaire ou encore à un mauvais contexte émotionnel, ce que Jean Paul Pes a souvent souligné dans ses écrits. Une séance au seuil faite « à l’arraché » après 10 heures de travail a-t-elle vraiment le même impact et apporte-t-elle le même bénéfice que si on l’effectue, tranquille, le samedi en fin d’après-midi ? Vous connaissez évidemment la réponse. Le problème est que, pour beaucoup, la réussite du programme passe par la réalisation obligatoire de certaines séances jugées essentielles, qui peuvent alors venir télescoper les autres activités de la journée, au risque de mal manger, mal récupérer, mal dormir, mal s’entraîner et mal vivre. Ce qui amène à se poser la bonne question : Quel est le meilleur entraînement ? C’est celui qui est le plus harmonieusement intégré à la vie du sujet. Le nombre de séances optimales sera alors fonction du temps qu’on peut objectivement y consacrer. La performance est « l’optimisation des aptitudes de l’athlète, le jour « J » en fonction de ses possibilités du moment ». Si on n’évalue pas ces dernières honnêtement (« je voudrais faire un marathon, mais ne peut courir que trois fois par semaine »), on finira par se blesser comme un « pro » pour avoir voulu s’entraîner comme un « pro ».
(*) : Le terme « surentraînement » me semble mal traduire ce qui se passe réellement dans cet état où on n’est plus du tout capable de se montrer aussi performant qu’on le souhaiterait ou qu’on l’a été. Il me semble que le terme de « désadaptation » conviendrait mieux, dans la mesure où cet état désagréable est la résultante de multiples facteurs et traduit l’incapacité de l’organisme à être présent sur plusieurs fronts à la fois.
SPÉCIFICITÉ OU DIVERSITÉ ? :
On s’interroge parfois également sur le bien-fondé de certains programmes lorsque, rapidement, le coureur ne progresse plus, même quand on augmente les charges d’entraînement. Or, cette absence de progression peut simplement traduire l’existence de terrains individuels limitatifs. Par exemple sur le plan métabolique. C’est ce qui avait amené certains physiologistes à parler de « bons » répondeurs ou de « mauvais » répondeurs à l’entraînement, ces derniers s’améliorant en moyenne trois à vingt fois moins que leurs camarades d’entraînement au potentiel initial comparable. C’est en partie génétique, et on n’y peut pas grand-chose.
Évidemment, cette diversité de réponses est souvent allègrement zappée par les spécialistes, dans la mesure où elle constitue une incongruité dans le raisonnement cartésien qui privilégie le contenu de l’entraînement, et oublie le sportif en route !
Pourtant, dès 1975, on lisait sous la plume du physiologiste russe Yakovlev que : « dans notre travail, on considère l’entraînement comme un processus adaptatif, c’est-à-dire une réponse des muscles squelettiques, des organes et des mécanismes biochimiques, propres à l’individu, et qui surviennent en réponse à divers stimuli ». Cette approche qui replaçait la réponse au cœur du débat, étayée par une multitude d’études, lui a permis de formuler le principe de la « spécificité de la réponse de l’organisme, qui survient à une multitude de formes d’activité musculaire ».
De ce fait, les discussions contradictoires d’experts sur la spécificité de l’entraînement, l’intérêt de l’entraînement croisé, la compatibilité du travail de force et de l’endurance, à propos desquels on lit tout et son contraire, avec force arguments très scientifiques, n’ont plus guère de sens, dans la mesure où l’important réside dans la réponse, et que celle-ci peut être obtenue en faisant appel à différents moyens. Ce qui va marcher chez l’un dans un contexte donné ne conviendra pas obligatoirement à tous, même si en variant les sollicitations on accroît le chance de réponse.
Tout dépend ensuite de ce qu’on recherche. On trouve par exemple, dans un domaine qui a beaucoup fait écrire, autant de partisans que de détracteurs à l’utilisation du vélo chez les marathoniens, et de promoteurs que d’adversaires des séances dites « à allure marathon ». Parfois d’ailleurs, certains vont très loin dans l’innovation, dans le souci de déstabiliser l’organisme pour accroître sa réponse. Assez étranger aux considérations d’éthique prévalant, paraît-il, à l’Ouest, Yakovlev testa la réactivité de ses athlètes à un entraînement donné, qu’il proposait dans un cadre « stressant », dans le froid, en altitude, de nuit, voire après une fausse annonce de mauvaise nouvelle (on était dans l’ex-URSS…) pour provoquer une réponse physiologique accrue. Ceci signifie, en fait, que l’important dans l’entraînement c’est la réponse, qui doit être si possible spécifique- correspondre à la discipline pratiquée-, et que cela peut passer par des stimuli variables, parfois assez éloignés- a priori- de l’activité dans laquelle le sportif se prépare. Comme avec la pratique de l’entraînement croisé, qui compta à ses débuts autant de partisans que de détracteurs.
LA MÉMOIRE EST LA…
Revenons à la « pensée complexe » qui va nous servir de cadre de réflexion pour l’entraînement. Elle pousse à la recherche de la relation d’interdépendance entre les différents éléments qui la composent. Selon cette logique, il paraît de plus en plus évident, aujourd’hui, qu’on ne peut pas raisonner sur l’efficacité d’un entraînement en faisant abstraction de toute la périphérie, alimentation, immunité, vie familiale ou professionnelle.
En cela, entendre un entraîneur affirmer que l’échec d’un athlète sur une compétition s’expliquerait par un travail insuffisant dans une filière donnée, par exemple par trop peu de séances accomplies à l’allure marathon chez un spécialiste des 42,195 km, n’a pas grand sens.
De la même manière que reproduire des protocoles ayant fait la preuve chez quelques-uns ne garantit pas la réussite systématique. Et ce pour plusieurs raisons. La première a trait à une loi simple de la physiologie, à savoir que 80% d’un effet est obtenu avec 20% de travail, et que les 20% restants nécessitent 80% de l’investissement de l’athlète. Le jeu n’en vaut pas la chandelle pour beaucoup d’entre nous, pour lesquels il paraît légitime, de ce fait, de ne pas s’astreindre à des programmes contraignants, en particulier si c’est au détriment de leur vie privée ou professionnelle.
Ceci explique également qu’un débutant peut très vite progresser quel que soit, à la limite, le principe d’entraînement adopté. On le voit d’ailleurs dans de nombreuses disciplines d’endurance, où le simple fait de sortir régulièrement, même à allure faible, procure très vite de gratifiants progrès. A l’inverse, la progression chez un athlète aguerri passe par un investissement qui peut déborder sur son mode de vie et le contraindre à des choix contradictoires, par exemple à s’entraîner le midi, ou tard le soir, à empiéter sur son temps de sommeil, ou à rapprocher exagérément deux séances difficiles pour rechercher une « surcompensation » plutôt aléatoire. Le bénéfice qu’il en tire est très peu évident.
C’est également pour cette raison qu’appliquer le principe d’entraînement d’un champion ayant réussi à la préparation d’un coureur de la masse peut être hors sujet, ne serait-ce que parce qu’ils ne se situent ni au même niveau de réponse physiologique, ni dans le même cadre de vie. Malgré cela, fort d’une approche cartésienne ou « pragmatique », la grande majorité des programmes d’entraînements proposés dans divers ouvrages ne prennent en compte que deux paramètres, le nombre de séances qu’on peut consacrer à l’entraînement et le niveau initial. Pourtant, selon qu’on travaille en 3 x 8 ou qu’on a par exemple connu préalablement une grave maladie virale (et ne parlons même pas du cancer d’Armstrong…), les réponses à un programme donné, chez deux sujets à dispositions identiques sur le papier, seront très variables.
LES MÊMES CAUSES NE DONNENT PLUS LES MÊMES EFFETS :
L’autre cause éventuelle à un échec de cette approche « analogique » classique telle qu’on la pratique habituellement réside dans l’un des principes de la pensée complexe, qui décrit le « vivant », et qu’on appelle la « récursion ».
 De quoi s’agit-il ? C’est l’un des éléments propres aux systèmes de contrôle physiologique et de l’adaptation de notre organisme, selon lequel existe un choc en retour entre la cause et l’effet. C’est par exemple le principe des mécanismes de contrôles hormonaux de notre corps, qui reposent sur des systèmes très fins où le produit final règle le niveau de sa propre synthèse, pour ajuster exactement en fonction des besoins du moment. Cela existe aussi dans le domaine de l’entraînement. Par exemple, lors de sa première exposition à l’altitude, un athlète va plus ou moins réagir favorablement (selon qu’il se range parmi les « bons » ou « mauvais » répondeurs » à l’altitude).
De quoi s’agit-il ? C’est l’un des éléments propres aux systèmes de contrôle physiologique et de l’adaptation de notre organisme, selon lequel existe un choc en retour entre la cause et l’effet. C’est par exemple le principe des mécanismes de contrôles hormonaux de notre corps, qui reposent sur des systèmes très fins où le produit final règle le niveau de sa propre synthèse, pour ajuster exactement en fonction des besoins du moment. Cela existe aussi dans le domaine de l’entraînement. Par exemple, lors de sa première exposition à l’altitude, un athlète va plus ou moins réagir favorablement (selon qu’il se range parmi les « bons » ou « mauvais » répondeurs » à l’altitude).
Mais par la suite, en retournant à Font-Romeu ou Albuquerque dans le même contexte, et en supposant qu’il se trouve dans le même statut nutritionnel, les modifications obtenues seront de moins en moins probantes. Sans doute à cause des adaptations et de l’espèce de « mémoire physiologique » qui s’ensuit, la même que celle qui permet de mieux répondre à un effort en altitude, même aigu, lorsqu’on y est déjà monté lors des mois précédents.
Cela signifie aussi que pour progresser, il n’est peut-être pas bon de reproduire à l’identique un programme qui a marché. Précisément parce que s’il a marché, c’est qu’il a favorisé des adaptations, et que celles-ci survenues et en partie conservées, les mêmes sollicitations, à nouveau proposées, déclencheront moins de perturbations dans l’organisme.
En fait, en matière d’entraînement, la pensée complexe nous amène à considérer que l’entraînement n’est rien sans l’aptitude du sujet à répondre. Or celle-ci se modifie constamment. Il est clair, de ce fait, qu’aucun programme n’a de valeur universelle et qu’au contraire il faut individualiser les préparations au maximum. Enfin, autre conclusion incontournable, la monotonie et la redite sont des sources de stagnation, voire d’échec. Quid des grands principes d’entraînement, de l’utilité du fractionné, des principes d’alternance, du « tapering », des trois séances hebdomadaires minimales propices à la santé et des quatre sorties optimales pour progresser ? Ces différentes connaissances théoriques restent bien sûr valables. Mais c’est dans la façon de les utiliser, de les adapter au cas par cas selon la situation du moment et en tenant compte des spécificités de chacun, qu’on aboutira à une pratique vraiment gratifiante, à tous points de vue…
Denis Riché
Doctorat en nutrition humaine et
Spécialiste français de la micronutrition
SDPO-mag 16 rue Jean Cocteau 95350 Saint Brice sous Forêt Tél : 01 39 94 01 87
Site Internet : www.sdpo.com Email : sdpo@sdpo.com









